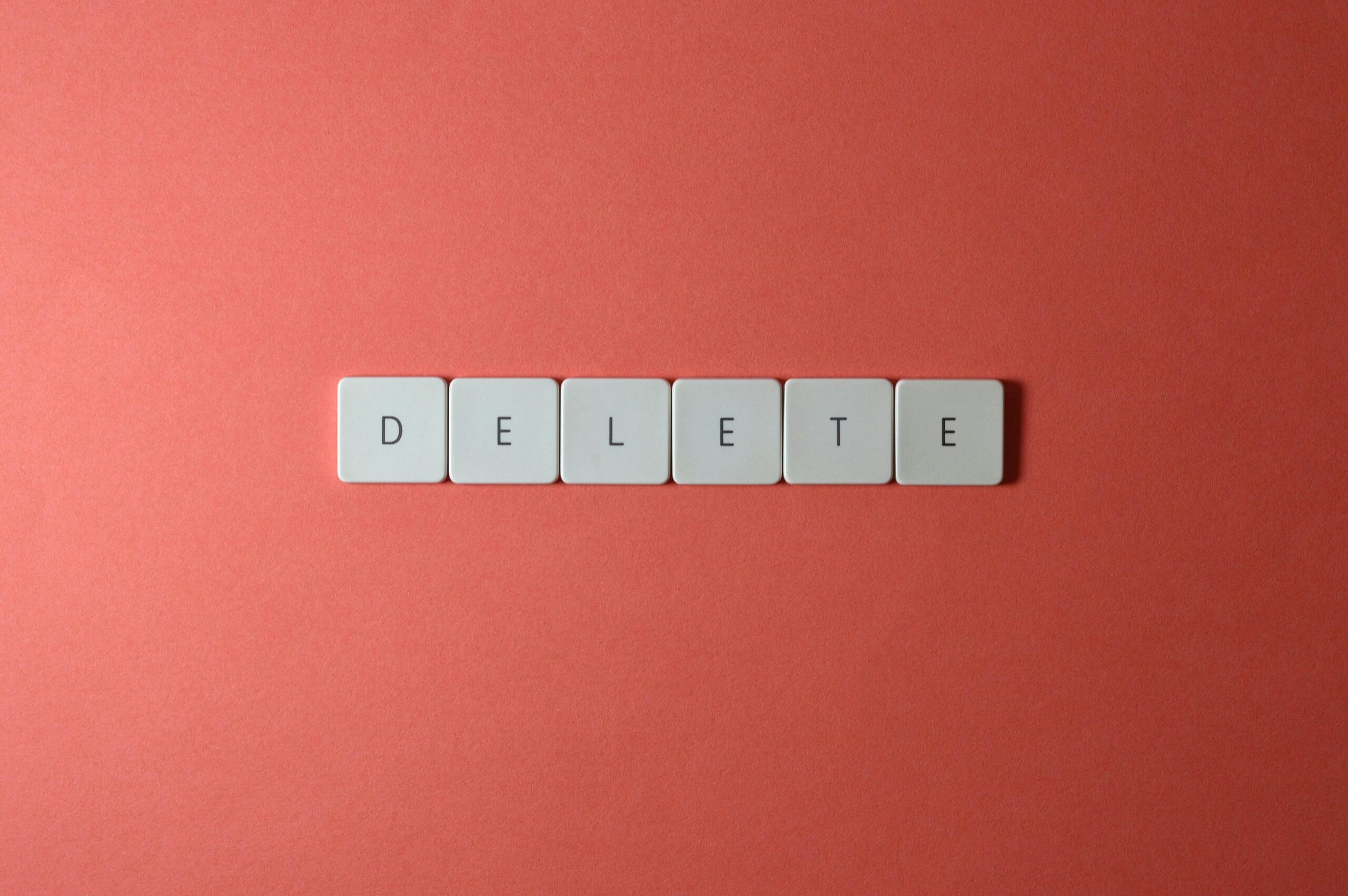Annulation d’une marque (INPI et EUIPO): Imaginez que vous avez investi du temps et des ressources pour bâtir votre marque. Un jour, vous recevez une notification indiquant qu’une action en nullité a été engagée contre elle. Que faire ? Quels sont vos droits ?
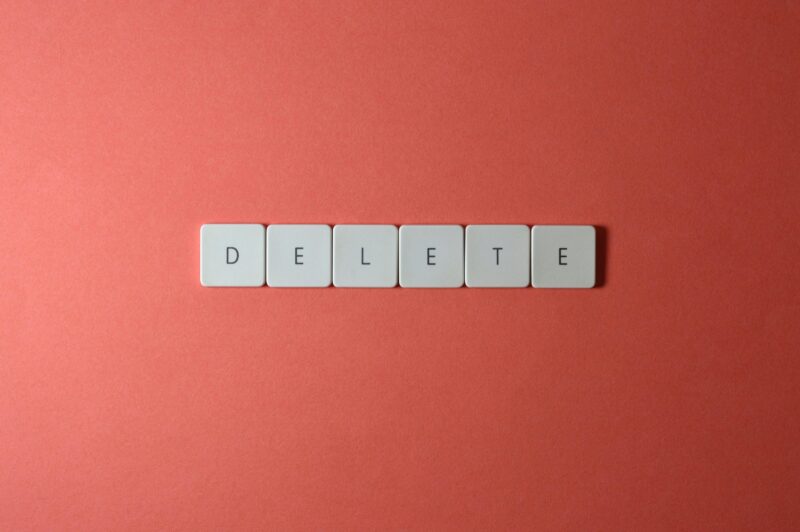
l’INPI est compétent pour statuer sur les demandes d’annulation de marque en France. Cette procédure rapide et accessible vise à assainir les registres en supprimant les marques qui violent des droits antérieurs. Mais comment fonctionne-t-elle ? Quels sont les critères d’évaluation ? Et surtout, comment protéger efficacement votre marque contre une éventuelle annulation ?
Dans cet article, nous allons explorer en détail les motifs relatifs de nullité, l’approche de l’INPI et les bonnes pratiques pour sécuriser votre marque.
Pourquoi est-il essentiel de comprendre l’annulation d’une marque ?
Depuis le 1er avril 2020, l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) a vu ses compétences renforcées en matière de contentieux des marques. Désormais, l’INPI peut directement statuer sur les actions en nullité et en déchéance, offrant ainsi une alternative plus rapide et moins coûteuse aux tribunaux.
Si vous êtes une entreprise, comprendre comment fonctionne l’annulation d’une marque est crucial. Pourquoi ? Parce que déposer une marque ne garantit pas automatiquement sa validité : un tiers peut en demander l’annulation si elle porte atteinte à des droits antérieurs. Voyons ensemble comment l’INPI évalue ces demandes.
Quels sont les motifs relatifs de nullité d’une marque ?
L’article L. 711-3 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) définit les motifs relatifs d’annulation d’une marque, c’est-à-dire les cas où une marque empiète sur des droits préexistants. Ces motifs incluent notamment :
- Une marque identique ou similaire désignant des produits/services identiques ou similaires, si cela génère un risque de confusion pour le public.
- Une marque bénéficiant d’une renommée en France ou dans l’UE, si son exploitation indue porte préjudice ou tire un profit injustifié de sa notoriété.
- Une dénomination sociale, un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine (à condition qu’ils ne soient pas de simple portée locale et qu’un risque de confusion existe).
- Une indication géographique enregistrée ou en cours d’homologation.
- Des droits d’auteur, des dessins ou modèles protégés, ainsi que des droits de la personnalité (nom de famille, pseudonyme, image).
- Le nom, l’image ou la renommée d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public.
- Le nom d’une entité publique, si son usage crée un risque de confusion.
L’INPI est compétent pour examiner ces motifs d’annulation d’une marque, à l’exception des cas relevant des droits d’auteur, dessins et modèles, et droits de la personnalité, qui restent du ressort des tribunaux judiciaires.
Comment l’INPI évalue-t-il ces motifs ?
L’INPI s’appuie sur des critères précis, inspirés de la jurisprudence européenne et française. Trois grands axes d’analyse sont suivis :
1. L’atteinte à une marque antérieure
L’INPI adopte une approche rigoureuse, similaire à celle de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). Voici les principaux critères :
- Preuve d’usage sérieux de la marque antérieure : la marque doit avoir été exploitée de manière continue pendant au moins cinq ans.
- Risque de confusion entre les produits/services concernés : nature, destination, utilisation et caractère concurrent ou complémentaire sont examinés.
- Comparaison des signes distinctifs : l’INPI évalue leur ressemblance globale en tenant compte de l’impression d’ensemble.
- Public pertinent : l’INPI analyse la perception des consommateurs moyens en fonction des produits et services.
- Caractère distinctif de la marque antérieure : plus la marque antérieure est forte, plus le risque de confusion est élevé.
2. L’atteinte à une marque de renommée
Lorsqu’une marque est très connue (ex. RICHARD MILLE, ELLE, TREK, PS5), son propriétaire peut demander l’annulation d’une marque postérieure si:
- La marque antérieure jouit d’une renommée avérée (intensité d’usage, notoriété auprès du public, investissements marketing).
- Un lien existe entre les deux signes dans l’esprit du public.
- L’usage de la marque postérieure cause un préjudice ou tire profit injustement de la marque antérieure.
3. L’atteinte à une dénomination sociale et/ou un nom de domaine
L’INPI exige que le demandeur prouve que sa dénomination sociale ou son nom de domaine est exploité de manière effective au moment du dépôt de la marque contestée. Une simple déclaration statutaire ou un enregistrement de nom de domaine ne suffisent pas.
L’INPI applique ici la jurisprudence stricte de la Cour de cassation et de la Cour de justice de l’UE (CJUE), qui impose notamment de prouver :
- L’exploitation effective du site internet associé au nom de domaine.
- Un lien avec le public français (ex. site en français, prix en euros, livraison en France).
Clarification des motifs absolus d’annulation d’une marque
L’article L.711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, issu de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, intègre de nouveaux motifs absolus de refus ou de nullité, conformément à la directive (UE) n° 2015/2436 du 16 décembre 2015. Auparavant dispersés dans plusieurs articles du Code, ces motifs sont désormais regroupés en onze catégories permettant d’annuler une marque enregistrée.
L’INPI adopte une approche structurée, inspirée des décisions de l’EUIPO, et simplifie la rédaction de ses décisions, notamment en abandonnant les formules juridiques complexes. Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance, son interprétation des motifs de nullité s’avère globalement alignée avec celle des juridictions françaises et européennes.
Critères issus de la jurisprudence européenne et française relative à l’annulation d’une marque
Parmi les onze motifs absolus de nullité, quatre ressortent particulièrement des décisions récentes de l’INPI :
1. L’absence de caractère distinctif
L’INPI évalue la distinctivité d’une marque en fonction des produits et services visés ainsi que de la perception du public pertinent, en s’appuyant sur la jurisprudence européenne. La charge de la preuve repose sur le demandeur de l’action en nullité. Le titulaire de la marque peut toutefois démontrer l’acquisition de distinctivité par l’usage.
Récemment, l’INPI s’est montré plus exigeant sur la présence d’éléments figuratifs. Par exemple, l’ajout d’une couleur verte et de motifs végétaux n’a pas suffi à conférer un caractère distinctif à une marque en raison de leur banalisation dans le marketing écologique.
2. L’atteinte à l’ordre public
L’article L.711-2 7° prévoit la nullité d’une marque contraire à l’ordre public ou à la légalité. L’INPI fusionne dans une même définition l’ordre public et les bonnes mœurs, englobant à la fois les règles juridiques et les normes sociales.
Certaines demandes ont été rejetées pour ces motifs, comme celles incluant des termes à connotation pornographique ou faisant référence au cannabis, même lorsqu’il s’agissait de produits à base de cannabidiol autorisés.
3. La mauvaise foi
Avant l’ordonnance, la mauvaise foi était déterminée par la jurisprudence. Désormais, l’article L.711-2 11° prévoit expressément la nullité d’une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi. L’INPI applique ainsi la jurisprudence selon laquelle la mauvaise foi se caractérise par la connaissance d’un usage antérieur et une intention malhonnête lors du dépôt.
4. Le caractère trompeur
Une marque est nulle si elle est de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance d’un produit. L’INPI s’aligne sur la jurisprudence européenne en exigeant l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave. Cette appréciation est d’autant plus stricte pour les produits alimentaires, où l’origine influence fortement la décision des consommateurs.
En savoir plus: consultez nos décisions relatives à l'annulation d'une marque!
Pourquoi la procédure d’annulation d’une marque est un atout pour les entreprises ?
La procédure de nullité d’une marque constitue un outil stratégique pour les entreprises en leur permettant de lutter efficacement contre des enregistrements abusifs ou gênants.
En facilitant la suppression des marques enregistrées en violation des règles du droit des marques (absence de distinctivité, mauvaise foi, caractère trompeur ou contraire à l’ordre public), elle contribue à assainir le marché et à éviter la confusion auprès des consommateurs.
De plus, la simplification de cette procédure devant l’INPI, notamment l’absence d’exigence d’intérêt à agir, permet aux entreprises de défendre leurs droits sans avoir à s’exposer directement, en confiant l’action à un tiers.
Ainsi, elles peuvent protéger leur identité commerciale, sécuriser leurs investissements et garantir une concurrence plus équitable.
La procédure administrative d’annulation devant l’INPI offre plusieurs avantages :
✅ Rapidité : En moyenne, 8,2 mois contre plusieurs années devant les tribunaux.
✅ Coût réduit : 600 € (+ 150 € par droit antérieur invoqué), bien inférieur aux frais judiciaires.
✅ Dématérialisation : Tout se fait en ligne, avec possibilité de présenter des observations orales.
✅ Taux de succès élevé : 88 % des décisions aboutissent à une annulation ou une déchéance.
Statistiques clés depuis l’entrée en vigueur de la procédure d’annulation d’une marque auprès de l’INPI:
📌 410 demandes en nullité déposées en seulement deux ans. 📌 400 décisions rendues, dont 32 % d’annulations au fond. 📌 29 % des marques contestées totalement annulées, 12 % partiellement annulées. 📌 11 % seulement des demandes en nullité rejetées.
Comment maximiser ses chances de succès ?
Si vous souhaitez contester une marque ou défendre la vôtre, une préparation rigoureuse est essentielle. Nos conseils :
🔍 Anticipez vos preuves d’usage : Documents commerciaux, campagnes publicitaires, certificats d’enregistrement. 📑 Structurez votre argumentation : Respectez les exigences formelles de l’INPI. 📝 Faites-vous accompagner par un expert en propriété intellectuelle.
En conclusion, cette nouvelle procédure constitue une avancée majeure pour assainir le registre des marques et éviter des conflits inutiles. Que vous soyez en position de défense ou d’attaque, la clé réside dans une approche stratégique et rigoureuse.
Besoin d’accompagnement ? Contactez les experts d’OOLITH AVOCATS !