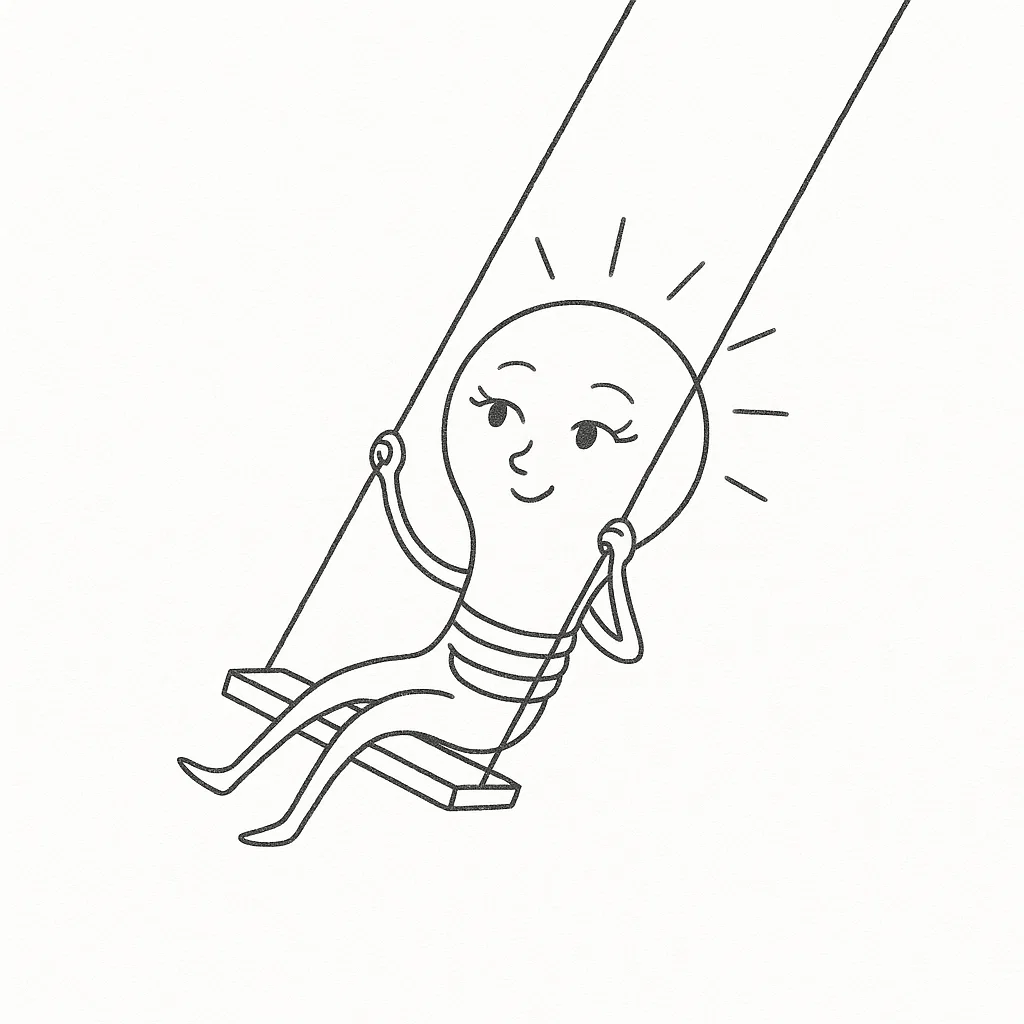L’activité inventive est indispensable pour qu’une invention puisse être protégée par un brevet auprès de l’INPI ou OEB. Elle garantit que seuls les véritables progrès techniques sont brevetables. Elle exclut les solutions qui paraissent évidentes à un spécialiste du domaine. Une invention est dite inventive si elle ne découle pas de manière évidente de l’état de la technique. L’état de la technique regroupe toutes les connaissances accessibles avant la date de dépôt du brevet. L’évaluation de cette condition se fait du point de vue de l’« homme du métier ». Il s’agit d’un expert possédant les compétences normales dans le domaine concerné. L’activité inventive protège l’innovation sans freiner la concurrence. Elle évite qu’un monopole soit accordé pour des améliorations évidentes. Elle incite les entreprises à investir dans de véritables avancées technologiques.
Définition de l’activité Inventive
L’activité inventive constitue une condition essentielle de la brevetabilité des inventions, aux côtés de la nouveauté et de l’application industrielle. Cette exigence est posée par l’article L. 611-14 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), ainsi que par l’article 56 de la Convention sur le brevet européen (CBE). Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas de manière évidente de l’état de la technique préexistant. L’appréciation de cette condition repose donc sur une évaluation du degré d’évidence de l’invention.
1. La reconnaissance de l’activité inventive
Contrairement à la nouveauté, l’activité inventive ajoute une exigence qualitative à l’examen de la brevetabilité. La loi du 5 juillet 1844 ne retenait que deux critères : nouveauté et application industrielle. Ce n’est qu’en 1968 que l’activité inventive a rejoint le droit français, par la loi du 2 janvier. Cette réforme a renforcé la sélectivité des brevets et mieux ciblé les véritables innovations. Dès les années 1950, des juristes avaient proposé ce troisième critère pour éviter la protection d’inventions trop évidentes. Leur objectif était de garantir que seuls les apports techniques réels soient protégés. La Convention de Strasbourg du 27 novembre 1963 a confirmé cette orientation. Elle a consacré l’activité inventive comme un pilier essentiel de la brevetabilité.
2. Le contenu de la condition d’activité inventive
Selon l’article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle, une invention est jugée inventive si elle ne résulte pas de manière évidente de l’état de la technique pour un homme du métier. Ainsi ; l’analyse de l’inventivité reposé sur 3 critères :
L’évidence
Une invention évidente n’est pas inventive. Cependant, la notion d’évidence soulève des difficultés d’appréciation. Les juges ont hésité entre une approche subjective, qui considère l’effort fourni par l’inventeur, et une approche objective, basée sur une comparaison avec les connaissances techniques existantes. L’approche majoritaire tend à privilégier une méthode objective, s’attachant aux indices préexistants qui auraient pu orienter naturellement un expert vers la même solution.
L’homme du métier
L’homme du métier est une figure de référence dans l’examen de l’activité inventive. Il s’agit d’un professionnel compétent du domaine technique concerné. Cependant, cet homme du métier ne doit ni être un simple exécutant, auquel cas toute invention paraîtrait inventive, ni un génie de l’innovation, ce qui rendrait toute invention évidente. L’appréciation de son niveau d’expertise est donc déterminante dans l’analyse de l’activité inventive.
L’état de la technique
L’état de la technique correspond à l’ensemble des connaissances accessibles avant la date de dépôt du brevet. Toutefois, l’étendue des références prises en compte pour l’activité inventive ne recouvre pas strictement celle de la nouveauté. Certains documents cités dans l’article L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle ne sont ainsi pas considérés dans l’évaluation de l’activité inventive.
Exemples jurisprudentiels:
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 9 juillet 2013, 12-18.135, Inédit
Résumé
En 2004, la société Carmeuse France et M. X ont déposé un brevet (n° 04 09767) portant sur l’usage d’une chaux vive partiellement pré-hydratée à réactivité retardée (CVRR) pour traiter les boues. L’invention visait à améliorer la séparation, la concentration et la dessiccation des matières solides présentes dans ces boues.
Les sociétés Lhoist, titulaires d’un brevet européen antérieur (EP 1 154 958), ont engagé une action en nullité. Elles soutenaient que leur propre invention décrivait déjà les éléments techniques repris dans le brevet de Carmeuse. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 30 mars 2012, a accueilli cette demande.
Elle a annulé les revendications 1 à 8 pour défaut de nouveauté, jugeant que les caractéristiques revendiquées se retrouvaient dans le brevet EP 1 154 958. Elle a aussi annulé la revendication 9, qui portait sur un matériau combinant une CVRR et un sel métallique, pour défaut d’activité inventive. Selon la cour, un professionnel du domaine aurait pu déduire cette combinaison en consultant l’état de la technique.
Or, sur ce point précis, la Cour de cassation casse la décision d’appel.
Focus : la question de l’activité inventive (revendication 9)
La revendication 9 du brevet Carmeuse portait sur un matériau destiné au traitement des boues, combinant une chaux vive à réactivité retardée (CVRR) et un sel métallique comme le chlorure ferrique ou le sulfate d’aluminium. Cette combinaison visait à assurer à la fois la séparation des phases solides et liquides et la décontamination des boues.
La cour d’appel avait annulé cette revendication pour défaut d’activité inventive, estimant qu’un professionnel du domaine aurait pu concevoir ce matériau en combinant des enseignements déjà disponibles, notamment ceux du brevet français FR 2 841 895 et du brevet européen EP 1 154 958.
La Cour de cassation a censuré ce raisonnement. Elle a d’abord relevé que les sociétés Lhoist n’avaient jamais invoqué le brevet EP 1 154 958 pour contester l’activité inventive de la revendication 9. En le faisant d’office, la cour d’appel a excédé les limites du litige et violé le principe du contradictoire, n’ayant pas permis aux parties de s’expliquer sur ce fondement nouveau.
De plus, la Cour a noté que l’instance d’appel n’avait pas défini l’“homme du métier”, référence essentielle pour apprécier l’évidence d’une invention. Enfin, elle a souligné que le brevet FR 2 841 895 concernait des usages différents, tels que des liants ou capteurs d’eau, et non le traitement des boues. L’utilisation de cette antériorité pour invalider la revendication était donc discutable. L’annulation a ainsi été jugée irrégulière.
Conclusion
L’activité inventive constitue un critère essentiel pour garantir que les brevets protègent de véritables avancées technologiques et non de simples améliorations évidentes. Son évaluation repose sur une analyse délicate de l’évidence, du rôle de l’homme du métier et de l’état de la technique. En établissant cette exigence, le droit des brevets préserve l’équilibre entre la protection de l’innovation et la libre concurrence, évitant ainsi une monopolisation excessive de solutions techniques accessibles aux spécialistes du domaine.
En savoir plus: Article 65 CBE : La Réforme de la Traduction des Brevets Européens grâce à l’Accord de Londres